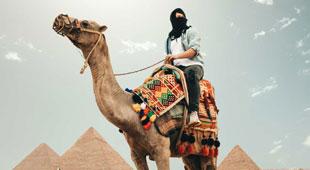La machine à sanctionner les chômeurs ne tourne pas à plein… Loin des craintes agitées par les syndicats avec l’application de la loi pour le plein-emploi (mise en œuvre depuis janvier 2025), les contrôles initiés pour vérifier si les demandeurs d’emploi effectuent bien des recherches actives d’emploi (ce qui n’a rien à voir avec la fraude) ont progressé, certes, mais n’explosent pas encore véritablement.
Selon le bilan effectué pour 2024, leur nombre a augmenté de 100 000 par rapport à 2023, passant de 516 000 contrôles à 616 000. Loin, très loin encore de l’objectif du 1,5 million par an fixé par les pouvoirs publics d’ici à 2027, aux 600 contrôleurs dont les effectifs sont amenés à s’étoffer : ils seront 853 en juin et 900 d’ici à la fin de l’année.
83 % des demandeurs d’emploi non sanctionnés
Répartis sur des plates-formes situées dans toute la France, ces conseillers sont dédiés uniquement à cette tâche. Ils sont chargés de vérifier via des outils informatiques que les personnes sont bien en recherche active d’emploi, condition pour percevoir une allocation. Soit en lançant des contrôles de façon ciblée (par exemple sur les demandeurs d’emploi identifiés sur des métiers en tension), soit de manière aléatoire (sur les bénéficiaires du RSA inscrits à France Travail), ou encore à la suite d’un signalement par un conseiller chargé de l’accompagnement. Une montée en charge et des changements d’échelle qui inquiètent les syndicats, et aussi dans les rangs des agents de France Travail.
Quant au nombre des sanctions, leur part est restée stable. C’est aussi ce qui ressort des chiffres, publiés ce jeudi 24 avril par l’opérateur, qui démontrent qu’une très large majorité de demandeurs d’emploi ciblés (83 %) ont confirmé des démarches actives ou des besoins de redynamisation. Seuls 17 % ont été sanctionnés, comme l’an passé, pour manque à leurs obligations de rechercher activement un emploi. En nombre, c’est un peu plus de 103 000 personnes concernées, contre 85 000 en 2023.
Quelles sont les sanctions ? Appelées « radiations » dans le jargon, elles consistent pendant une durée moyenne d’un mois à priver les chômeurs d’allocation chômage et d’accompagnement. Des règles qui doivent changer au 1er juin avec un nouveau système appelé « suspension-remobilisation » et un barème rénové de sanctions, « plus juste » fait valoir la direction de France Travail. Le décret est actuellement au Conseil d’État.
« Une pression tous azimuts sur les contrôleurs »
« Il faut chasser les fantasmes sur le sujet des contrôles. Cela vise surtout à lutter contre le décrochage, à détecter les signes de découragement. On a conscience que retrouver un job peut ne pas être simple », a plaidé Jean-Pierre Tabeur à la direction de France Travail, lors d’une conférence de presse aux allures d’opération déminage, rappelant le principe des « droits et devoirs ».
Au cœur des inquiétudes ambiantes, le recours accru aux outils numériques pour effectuer ces contrôles, dont des robots (algorithmes) pour analyser les dossiers des demandeurs d’emploi ou le recours à l’IA (intelligence artificielle) générative. Bien que les décisions soient encore aux mains des contrôleurs et des conseillers, les syndicats craignent que la digitalisation mène à une automatisation complète.
« On fait des tests, mais pas question pour nous de supprimer l’intervention humaine », assure encore Jean-Pierre Tabeur. « En ce moment, certaines directions locales des plates-formes comparent ce que font les robots et les agents sur l’analyse des dossiers des chômeurs contrôlés, des propositions de remobilisation ou de sanctions », affirme néanmoins ce représentant syndical de la CGT. Et de pointer « une pression tous azimuts sur les contrôleurs qui peut conduire, par facilité, à nuire surtout aux plus précaires ».